

INTRODUCTION:

L’Empire ottoman (Osmanlı İmparatorluğu en turc moderne, دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه Devlet-i Âliye-i Osmâniyye en endonyme turc ottoman) est un empire qui a duré de 1299 à 1923 (soit 624 ans). Il a laissé la place, entre autres, à la République de Turquie. Fondé par un clan turcique oghouz en Anatolie occidentale, l'Empire ottoman s'étendait au faîte de sa puissance sur trois continents : toute l'Anatolie, le haut plateau arménien, les Balkans, le pourtour de la mer Noire, la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie, la péninsule Arabique et l'Afrique du Nord (à l'exception du Maroc, de la Kabylie, des Aurès et du Sahara algérien).
LES DEBUTS :
 L'Empire ottoman est fondé par une famille issue des
Kayı, l'une des vingt-quatre tribus turciques
oghouz, qui avaient conquis l'Anatolie
au
XIe siècle,
au détriment de l'Empire
byzantin. Pendant que le premier sultanat turc des
Seldjoukides se décompose, cette tribu monte en
puissance sous le règne d'Osman
Ier.
En 1299, Osman conquiert la ville byzantine de Mocadène, aujourd'hui
Bilecik. Cette date marque le commencement de
l'Empire ottoman et le début de la constitution de la première véritable
armée ottomane. Jusqu'à sa mort en
1326, Osman Ier
conquiert plusieurs autres villes et places fortes byzantines, ainsi que
certaines principautés turques voisines.
L'Empire ottoman est fondé par une famille issue des
Kayı, l'une des vingt-quatre tribus turciques
oghouz, qui avaient conquis l'Anatolie
au
XIe siècle,
au détriment de l'Empire
byzantin. Pendant que le premier sultanat turc des
Seldjoukides se décompose, cette tribu monte en
puissance sous le règne d'Osman
Ier.
En 1299, Osman conquiert la ville byzantine de Mocadène, aujourd'hui
Bilecik. Cette date marque le commencement de
l'Empire ottoman et le début de la constitution de la première véritable
armée ottomane. Jusqu'à sa mort en
1326, Osman Ier
conquiert plusieurs autres villes et places fortes byzantines, ainsi que
certaines principautés turques voisines.
EXPANSION VERS L EUROPE
 (mehmedII) Ses successeurs continuent sa politique d'expansion. L'Empire
ottoman conquiert
Gallipoli, son premier territoire européen, en
1347, puis s'étend à travers les
Balkans. En
1389, la victoire décisive à la
bataille du champ des Merles en
Serbie, dans l'actuel
Kosovo, marque la fin de l'existence des
royaumes serbes. La Serbie est définitivement annexée par les Ottomans après la
chute de
Smederevo, en
1459. En
1453, commandées par le sultan
Mehmet II, les armées ottomanes
prennent Constantinople et mettent fin à
l'Empire byzantin, établissant ainsi la domination de l'empire sur la partie à
majorité chrétienne de la
Méditerranée orientale. Plusieurs croisades
européennes sont écrasées à
Nicopolis et
Varna ou encore à
Alger .
(mehmedII) Ses successeurs continuent sa politique d'expansion. L'Empire
ottoman conquiert
Gallipoli, son premier territoire européen, en
1347, puis s'étend à travers les
Balkans. En
1389, la victoire décisive à la
bataille du champ des Merles en
Serbie, dans l'actuel
Kosovo, marque la fin de l'existence des
royaumes serbes. La Serbie est définitivement annexée par les Ottomans après la
chute de
Smederevo, en
1459. En
1453, commandées par le sultan
Mehmet II, les armées ottomanes
prennent Constantinople et mettent fin à
l'Empire byzantin, établissant ainsi la domination de l'empire sur la partie à
majorité chrétienne de la
Méditerranée orientale. Plusieurs croisades
européennes sont écrasées à
Nicopolis et
Varna ou encore à
Alger .
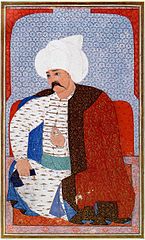 (SELIM I)
(SELIM I)
Pragmatiques et non dogmatiques, les sultans ottomans n’ont pas fait table rase de la civilisation byzantine mais l’ont au contraire adaptée et développée, comme en témoignent la mosquée bleue qui sublime l’architecture de la basilique Sainte-Sophie ou les thermes, que nous appelons bains turcs. L’Empire a su hériter de l’éducation, des sciences, des techniques et des universités byzantines, devenues ottomanes et admirées dans toute l’Europe à la fin du Moyen Âge. Ces universités orientales se tenaient au courant des découvertes occidentales : l’amiral Piri Reis a ainsi pu faire une copie de la carte de l’Amérique de Christophe Colomb, et celle-ci ayant été perdue, la copie de Reis est à ce jour la plus ancienne carte du nouveau continent. De grandes forces vives, aussi bien intellectuelles que financières, vinrent renforcer la Sublime Porte. On peut citer les migrations et installations des juifs sépharades, fuyant l’Espagne répressive et l’Inquisition, puis celles des Morisques andalous.
En 1517, Sélim Ier conquiert l’Égypte et met fin au sultanat mamelouk. Le calife abbasside Al-Mutawakkil III est emmené à Istanbul comme otage, et aurait cédé son titre de Commandeur des croyants (Emir al-mumimin). Si Selim procède au transfert de certaines reliques de Mahomet à Istanbul, la thèse selon laquelle il aurait voulu recueillir l’héritage de califat est cependant sujette à caution et apparaît beaucoup plus tardivement3. Moins d’un siècle après avoir mis fin à l’Empire byzantin moribond, les Turcs ottomans prennent la succession de la dynastie arabe des Abbassides.
 (Soliman le magnifique)
(Soliman le magnifique)
Au XVIe siècle, sous le règne de Soliman le Magnifique, les armées ottomanes parviennent jusqu’à Vienne en 1529 et 1532, dont elles font le siège en vain. Cette avancée marque la limite de l’expansion de l'Empire en Occident (comme Aden en fixera la limite au sud).
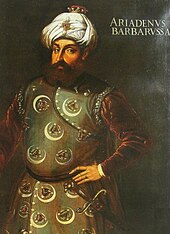
.jpg/220px-Battle_of_Preveza_(1538).jpg)
De 1533 à 1536, l’Empire ajoute l’est de l’Anatolie, l’Azerbaïdjan et le Yémen. Les corsaires turcs installés à Alger prennent Tunis aux Hafsides en son nom en 1534, puis la perdent face aux troupes de Charles Quint. Le pacha turc de Tripoli prend Kairouan en 1557 et Tunis est reconquise, définitivement cette fois, en 1569.
L’Empire crée une flotte militaire, tente de s’imposer en Méditerranée au détriment des cités italiennes et y parvient un moment. La défaite navale de Lépante en 1571, devant les flottes espagnole et vénitienne, met fin à sa suprématie. Réorganisée par Sokullu Mehmed pacha, la flotte ottomane restera certes ensuite une puissance importante, et les possessions vénitiennes (Chypre et des îles en mer Égée) rejoindront progressivement l'Empire mais une partie toujours plus importante du commerce méditerranéen était sous le contrôle de Venise, de Gênes, du Portugal et de l'Espagne4.
L'Empire trouve sa place dans le jeu diplomatique européen où il est un allié traditionnel de la France, dans une alliance de revers contre les Habsbourgs, dès le règne de François Ier.
UNE PUISSANCE MONDIALE CONTESTE :
La mort de Soliman le Magnifique en 1566 marque la fin de l'âge d'or ottoman, et la superficie de l'Empire au XVIe siècle atteint 5 200 000 km² 1. L'irruption des Portugais dans l'océan Indien détourne vers l'Atlantique une grande partie du commerce des Indes, et les expéditions ottomanes contre Goa et Mascate n'arrivent pas à les en déloger. Cependant, le commerce du Levant reprend à la fin du XVIe siècle.
L'Empire ottoman a encore les moyens de grandes expéditions sur mer (conquête de Chypre en 1570 et de la Crète en 1669) et sur terre, contre les Autrichiens et les Russes. Moscou est incendiée en 1571, Vienne, capitale des Habsbourg d'Autriche, assiégée en 1683. L'empire croit avoir encore une vocation mondiale. Sokullu Mehmed pacha, Grand Vizir de Selim II, commence un projet de canal à Suez et entre la Volga et le Don, qui n'aboutira pas.
Dans l'Europe du Sud, une coalition d'États compte alors vaincre l'Empire ottoman sur les mers, puisqu'elle ne le peut sur les terres. À Lépante, envoyé par le roi Philippe II d'Espagne, une flotte coalisée (États pontificaux, République de Venise et Espagne) affronte la grande flotte turque, réputée invincible. En 1571, Lépante voit la destruction de plus de 250 galères turques. Mais c'est une victoire sans lendemain, qui ne touche pas aux bases de la puissance turque. Le Grand Vizir ottoman dira à un ministre vénitien durant des négociations : « En vous prenant Chypre, nous vous avons coupé un bras. En envoyant par le fond notre flotte, vous nous avez coupé la barbe. » En 1573, la flotte ottomane reconstituée pousse les Vénitiens à la paix. Cela permet au sultan de tourner ses ambitions sur l'Afrique du Nord.
Les frontières ottomanes ne changent guère entre 1566 et 1683. Les guerres finissent sur des statu quo et les victoires de Soliman le Magnifique apparaissent comme un glorieux passé. Les Séfévides de Perse repoussent les assauts turcs. Dans les régions danubiennes, l'empire doit faire face à la puissance rivale de l'Autriche et à l'insoumission des principautés roumaines sous Michel le Brave (1593-1601). Le Liban se rend temporairement indépendant sous l'émir druze Fakhr-al-Din II (1590-1613).
Sur les champs de bataille, l'armée ottomane, ou plutôt, comme l'appellent les chroniqueurs turcs, « l'armée de l'islam"5 », reste une puissance impressionnante. Des forces nombreuses, ce qui suppose une logistique considérable, des janissaires d'élite, et toujours des légions de soldats armés d'arquebuse ou de fusils. La Longue Guerre contre l'Autriche (1593-1606), a demandé de grandes ressources humaines aux Ottomans. Leur population forte de trente millions d'habitants leur permet de soutenir de vastes efforts de guerre mais le retard économique et technique face à l'Occident commence à se faire sentir.
LE DÉBUT DU DÉCLIN :
 Au
XVIIe siècle
l’âge d’or de l’Empire
ottoman est déjà révolu, comme l'indique la défaite navale de la
flotte ottomane face à une ligue réunissant l’Espagne,
Rome,
Malte et
Venise à
Lépante en
1571. Cette première défaite majeure n’eut pas de répercussion
immédiate, mais elle marquait un tournant dans l’histoire de l’État ottoman et
un regain de confiance dans la puissance de l’Europe chrétienne.
Au
XVIIe siècle
l’âge d’or de l’Empire
ottoman est déjà révolu, comme l'indique la défaite navale de la
flotte ottomane face à une ligue réunissant l’Espagne,
Rome,
Malte et
Venise à
Lépante en
1571. Cette première défaite majeure n’eut pas de répercussion
immédiate, mais elle marquait un tournant dans l’histoire de l’État ottoman et
un regain de confiance dans la puissance de l’Europe chrétienne.
 (osmanII)
(osmanII)
Le déclin de l’Empire devient de plus en plus manifeste lorsque Osman II (1618-1622) est assassiné par les janissaires protestant contre ses tentatives de réforme, ce qui engendre une dégradation de l’autorité des sultans et du pouvoir central.
En effet, l’échec du second siège de
Vienne (1683),
le traité de Karlowitz en
1699 (premier traité défavorable aux Ottomans) et le
traité de Kutchuk-Kaïnardji (1774),
reflètent l’affaiblissement grandissant de l’Empire et marquent le début d’une
crise qui va durer jusqu’au
XXe siècle.
La
campagne d’Égypte, expédition militaire
entreprise par
Napoléon Bonaparte (1798-1801),
et l’invasion par les troupes du gouverneur de l’Égypte,
Mehmed Ali, de la
Syrie, secouent brutalement les fondements de
l’État ottoman et l’obligent à rechercher des solutions pour les crises qui
éclatent au sein de l’Empire : c’est l’époque des Tanzimat.
LE TEMPS DES TROUBLES :


Sous les règnes de Mehmed III (1595-1603) et de son fils Ahmet Ier (1603-1617), l’empire est en proie à des révoltes et à des soulèvements militaires, notamment celui des spahis à Constantinople au début de l'année 1603. Pour tenter d’assurer leur pouvoir, les sultans ottomans changent fréquemment les vizirs, les conseillers, les chefs militaires et les membres de la haute administration. Il en résulte que les administrateurs s’efforcent de réaliser des fortunes rapides par tous les moyens6. Le personnel subalterne, moins surveillé, s’empresse de les imiter. Des peuples soumis, pressurés par les fonctionnaires, se soulèvent contre les Turcs, notamment les Druzes.
Après l’humiliant traité signé avec les Séfévides en 1590, les Ottomans occupent la Géorgie, le Chirvan, le Lorestan, et Tabriz avec une partie de l'Azerbaïdjan7. La guerre reprend en 1603 avec la prise de Tabriz par Abbas Ier le Grand, qui reconquiert en quelques années l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Mésopotamie avec Bagdad sur les Ottomans (1612)8.
En Europe, la paix de Zsitvatorok (Hongrie) conclut la Longue Guerre avec le Saint-Empire romain germanique. Le sultan consent pour la première fois à traiter à égalité avec l'empereur et le tribut annuel est transformé en « présents »6. La Porte conserve Kanizsa, Esztergom et Eger, mais abandonne la région de Vac. Sa progression vers l'est est stoppée.
 (
janissaires)
(
janissaires)  (spahis)
(spahis)
Au début du XVIIe siècle, l’armée turque est forte de 150 000 à 200 000 hommes. Elle comprend trois éléments : les odjaks, milices soldées par le Trésor (janissaires, spahis, artilleurs, soldats du train, armuriers, gardes des jardins palatins), troupes irrégulières, de moins en moins recrutées et les troupes de province, fournies par les feudataires (les plus nombreuses). Les fiefs (timars et zaïms) attribués à des militaires (sipahi) qui doivent fournir un contingent passent progressivement aux serviteurs du seraï, ce qui les soustrait aux obligations du service. Les troupes de province fournissent de moins en moins de soldats. De 1560 à 1630, les odjaks augmentent d’autant, surtout le corps des janissaires, multiplié par quatre. La pression fiscale augmente et alimente des troubles provinciaux. Les janissaires forment un État dans l’État et sont recrutés de plus en plus parmi les musulmans. Ils obtiennent le droit de se marier et s’installent dans la vie de garnison, spécialement à Constantinople. Les Turcs obtiennent l’autorisation de servir parmi les janissaires, autrefois composés exclusivement d’esclaves chrétiens. Le corps des janissaires devient une garde prétorienne et arbitre les compétitions dynastiques.les janissaires arrivent à s'imposer et bloquent toutes les réformes voulues par le sultan. Ce n'est pas la première intervention de ces soldats d'élite dans la politique, puisqu'ils avaient déjà déposé ou tué quatre sultans, Mustafa Ier, Osman II, Ibrahim Ier et Mehmed IV, au cours du XVIIe siècle. Le pouvoir de ce corps de troupe va alors ne faire que grandir. Abdülhamid Ier, frère de Mustafa, ne peut empêcher l'annexion de la Crimée tatare par l'Empire russe de Catherine II en 1782. Désormais, la mer Noire n'est plus sous le contrôle total des Ottomans. Dans cette série des règnes destructeurs pour l'Empire, celui de Sélim III, successeur du précédent, s'illustre par l'apogée du pouvoir des janissaires qui, n'acceptant pas ses idéaux réformateurs, se révoltent en 1807 et l'assassinent en 1808.
L' EMPIRE ASSIÉGÉ
 (Guerre turcs autrichiens)
(Guerre turcs autrichiens)
Durant cette période de stagnation, une partie des territoires danubiens est cédée à l'Autriche. Des territoires comme l'Algérie ou l'Égypte deviennent de plus en plus indépendants vis-à-vis d'Istanbul. Sur leur frontière nord, vers l'Ukraine actuelle, les Ottomans font reculer l'Empire russe de Pierre le Grand, mais ils subissent une série de défaites cuisantes sous le règne de Catherine II, qui envoie sa flotte en mer Égée et s'empare de la Crimée en 1782.
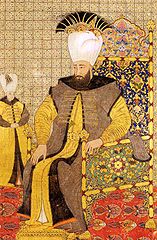 (ahmed III)
(ahmed III)
Cette période se caractérise par une tentative des Sultans et des Vizirs de réformer leur Empire en déliquescence. L'ère des tulipes (Lâle Devri en turc), ainsi nommée en hommage à l'amour que portait le sultan Ahmet III à la plante, semble une sorte de retour de l'Empire ottoman sur le devant des scènes européennes, aussi bien économiques que politiques. Alors qu'une guerre contre l'Autriche vient d'être à nouveau perdue en 1718, et que l'Empire s'est vu humilié au traité de Passarowitz la même année, Ahmet III tente de nouvelles réformes envers le peuple : les taxes sont moins fortes, l'image de l'Empire est redorée, et des entreprises, semblables aux manufactures européennes, sont créées. Il tente aussi de moderniser l'armée avec des conseillers européens.
 (patrona
khalil )
(patrona
khalil )
En 1730, un janissaire d'origine albanaise, Patrona Halil, fomente un complot contre le sultan Ahmet III. Celui-ci n'avait pas suivi les propositions de réformes proposées par Halil. Face à cela, Patrona Halil et d'autres janissaires proclament Mahmud Ier sultan. Ahmet III aura eu le temps de faire exécuter Halil mais doit quitter le pouvoir après cette insurrection.Les émeutiers déposèrent et emprisonnèrent Ahmed III. Pendant des semaines après la révolte, l'empire fut entre les mains des insurgés. Patrona Halil conduisit le nouveau sultan à la Mosquée Eyüp Sultan pour la cérémonie d'intronisation où ce dernier fut ceint de l'épée d'Osman. Patrona apparaissait devant le sultan jambes nues et dans son vieil uniforme de soldat ordinaire. La plupart des officiers principaux furent déposés et remplacés par des sbires du rebelle, qui avait servi dans les janissaires. Un boucher grec, Yanaki, qui avait fait crédit à Patrona et lui avait même prêté de l'argent, fut ainsi nommé hospodar de Moldavie par le Divan. Yanaki ne prit jamais son poste. Le Khan de Crimée aida le grand vizir, les muftis et les aghas des janissaires à réprimer la rébellion. Patrona fut tué en présence du sultan après un conseil durant lequel il avait réclamé une déclaration de guerre à la Russie (). Son ami grec, Yanaki, et 7 000 de ses partisans furent exécutés. La jalousie avec laquelle les officiers janissaires le considéraient, et leur volonté de participer à sa chute facilitèrent les efforts des partisans de Mahmud Ier pour mettre fin à la rébellion.
LA CHUTE:
 (Abdülmecit
II , dernier sultan et calife)
(Abdülmecit
II , dernier sultan et calife)
En 1913, la défaite de la seconde guerre balkanique amène les Jeunes-Turcs (Parti Union et Progrès) au pouvoir. Leur volonté de relever l'empire les entraîne dans l'alliance avec l'Empire allemand. En 1914, ils déclarent la guerre à l'Entente, et entreprennent de grandes offensives vers l'Égypte et le Caucase. Ce sont des échecs : l'empire n'a pas les moyens de sa politique, il est ravagé par les épidémies et les famines. Des tensions internes apparaissent alors dans tout l'empire. La Grande révolte arabe a lieu entre 1916 et 1918. La rébellion est menée par Hussein ben Ali, chérif de La Mecque, afin de libérer la péninsule Arabique et de créer un État arabe unifié allant d’Alep à Aden. L'appel à la guerre sainte, lancé par le sultan comme calife de l'islam, a peu d'échos. L'existence même de l'Empire est menacée aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.
En 1915, le noyau du parti organise, sous le commandement du ministre de l'Intérieur Talaat Pacha, une politique de déportation et de massacre des Arméniens ottomans, politique appelée génocide arménien, faisant entre 800 000 et 1 500 000 morts selon la majorité des historiens, et entre 300 000 et 500 000 victimes selon l'État turc actuel. Celui-ci refuse le terme « génocide » et préfère parler de massacres, en les justifiant parfois par la menace que constituait pour la Turquie une population chrétienne arménienne vivant de part et d'autre de la frontière Russo-Turque11. La culpabilité de Talaat, Enver Pacha et autres dirigeants Jeunes-Turcs, a bien été reconnue par la justice ottomane qui les a condamnés à mort par contumace en juillet 1919, mais ce verdict a été annulé ensuite par la réaction nationale turque. En fait, certains considèrent qu'il s'agit du premier génocide du XXe siècle : les deux tiers de la population arménienne de l'Empire ottoman furent exterminés. C'est également dans ce contexte troublé que, entre 1914 et 1920, a lieu le génocide assyrien causant la mort de 500 000 à 750 000 personnes ce qui représente environ 70 % de la population assyrienne de l'époque12.,13. Le génocide grec pontique fait lui entre 350 000 14 et 360 000 morts15 entre 1916 et 1923.
La Première Guerre mondiale achève son démembrement car l'Empire ottoman, allié aux Austro-Hongrois et aux Allemands, se trouve dans le camp des vaincus. À la suite du traité de Sèvres, ses territoires arabes (Syrie, Palestine, Liban, Irak, Arabie) sont placés par décision de la Société des Nations sous mandats britannique et français (voir accord Sykes-Picot). La côte égéenne est occupée par les Grecs et les Italiens.
VERS LA RÉPUBLIQUE:
L'effondrement de l'empire éveille le sentiment national turc. Les anciens combattants se rassemblent autour du maréchal Mustafa Kemal Atatürk, qui chasse les Européens d'Anatolie et s'impose comme chef du gouvernement, reléguant le sultan à un rôle honorifique. En 1923, il abolit l'Empire ottoman et fonde sur le territoire restant, l'Anatolie, la grande partie ouest du haut-plateau arménien et la Thrace orientale, la Turquie moderne ou la République de Turquie, État successeur de l'Empire ottoman. En 1924, il met fin au califat, dernière trace des institutions impériales.